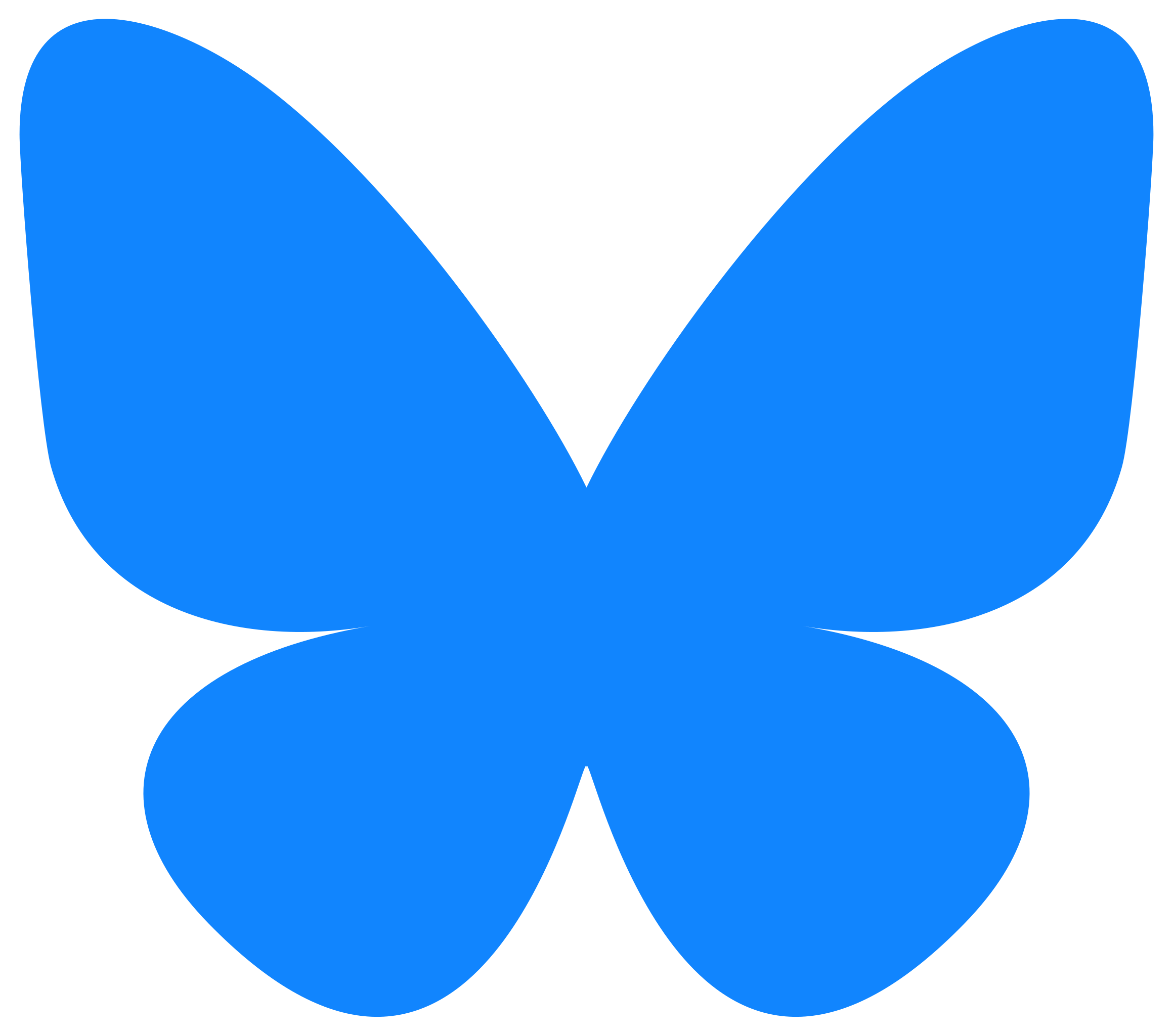Cette année, cela fera quinze ans que le Canada a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Et pourtant, l’objectif de vivre dans une société pleinement inclusive et accessible reste hors de portée des Canadiens handicapés.
Bien qu’il y ait eu quelques progrès — notamment l’introduction de lois sur l’accessibilité fédérales et provinciales et une nouvelle prestation d’invalidité nationale — des obstacles demeurent, menaçant la santé et le bien-être des personnes handicapées et de leur famille.
Il est temps d’éliminer ces obstacles, particulièrement à l’échelle des provinces et des territoires, où des politiques fragmentées empêchent les gens d’accéder aux programmes et aux services dont ils ont besoin et entraînent des inégalités.
Intitulé Politiques en matière de handicaps au Canada : Rapport provincial et territorial et préparé par le Réseau pour la santé du cerveau des enfants, un nouveau rapport décrit et compare ces politiques et tire la sonnette d’alarme sur les écarts importants et les inégalités que l’on retrouve partout dans le pays.
À l’heure actuelle, chaque province et territoire établit ses propres politiques en matière de handicap en vase clos. Cela veut donc dire que le type et le degré de mesures de soutien non fédérales accessibles aux Canadiens handicapés varient en fonction de leur lieu de résidence.
Un exemple frappant en est que tous les ressorts territoriaux n’offrent pas nécessairement des programmes d’aide au revenu spécifiquement conçus pour les personnes handicapées. Même lorsque c’est le cas, le montant de ce soutien varie grandement d’une province à l’autre, et un grand nombre d’entre elles ne donnent pas assez pour subvenir au coût de la vie. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, dans le cadre du programme d’allocation de complément de ressources et de supplément d’invalidité, un adulte célibataire handicapé peut recevoir jusqu’à 986 dollars par mois. Par contraste, en Alberta, dans le cadre de l’assurance-revenu pour les personnes gravement handicapées (AISH), un adulte célibataire handicapé peut recevoir jusqu’à 1 863 dollars par mois.
Même si tous les ressorts territoriaux offrent des programmes de prestations d’invalidité dans le cadre de leur régime d’impôt sur le revenu, le type de programme fiscal, les critères d’admissibilité et le maximum des montants varient. Par exemple, un adulte handicapé en Saskatchewan peut déduire 10 405 dollars de sa déclaration d’impôt sur le revenu au titre du montant d’invalidité, tandis qu’au Manitoba, cette somme ne s’élève qu’à 6 180 dollars.
Des lacunes de législation sur l’accessibilité ne font qu’aggraver ces inégalités. Certains ressorts territoriaux n’ont pas encore adopté de lois rendant obligatoires des mesures permettant de cerner, d’éliminer et de prévenir les obstacles aux biens, aux services, aux bâtiments et à l’emploi auxquels se heurtent les personnes vivant avec des handicaps.
Dans les provinces dotées de lois sur l’accessibilité, les résultats sont mitigés, car certaines n’ont pas atteint les objectifs et les délais fixés par la législation ou n’ont pas appliqué celle-ci.
Ce rapport inclut les constats tirés de sondages et d’entrevues effectués auprès de centaines de parents et d’aidants naturels partout au Canada, qui ont parlé des obstacles qu’ils ont rencontrés personnellement lorsqu’ils ont essayé d’accéder à des programmes provinciaux et territoriaux pour personnes handicapées.
La plus grosse difficulté citée par eux consiste en un processus de demande fastidieux et interminable. Les formulaires comportent souvent plusieurs pages et demandent des informations détaillées qui exigent la contribution de professionnels de la santé.
Non seulement ces tracasseries administratives prennent beaucoup de temps, mais elles sont souvent accablantes et épuisantes émotionnellement dans la mesure où les personnes handicapées et leurs aidants naturels se voient poser les mêmes questions sur leur invalidité pour chaque programme dont ils font la demande.
Certaines familles ont même du mal à trouver les programmes pour personnes handicapées qui existent dans leur province ou territoire et comment en faire la demande. Dans certains cas, elles ne les découvrent qu’en parlant à d’autres parents.
Une fois qu’elles ont trouvé un programme, elles sont confrontées à de longues périodes d’attente. Partout au pays, des parents et des aidants naturels ont indiqué que les listes d’attente sont très longues — ainsi, rien qu’en Ontario, plus de 60 000 enfants sont en attente pour le programme provincial sur l’autisme.
La situation est si catastrophique que les enfants sont parfois sur liste d’attente pendant des années et dépassent l’âge limite des programmes avant d’avoir pu y accéder, ce qui freine leur développement et force les familles à chercher des solutions de remplacement qui les mettent sous pression émotionnelle et financière.
Les seuils de revenus permettant de bénéficier de programmes de prestations d’invalidité, lorsqu’ils sont trop bas ou ne tiennent pas compte du plein coût du handicap, constituent un autre obstacle. Les familles doivent souvent se débrouiller comme elles peuvent pour trouver l’argent supplémentaire dont elles ont besoin pour obtenir des mesures de soutien. Dans certains cas, les parents sont forcés de prendre un second emploi.
Dans certaines situations, les parents qui se voient refuser des mesures de soutien ou des services essentiels pour leur enfant handicapé n’ont pas d’autre choix que de quitter leur emploi pour s’occuper de lui.
Il est du devoir des gouvernements provinciaux et territoriaux de remédier d’urgence aux lacunes en matière d’accessibilité, mais il faut qu’ils le fassent en partenariat — en collaborant les uns avec les autres pour déterminer des pratiques exemplaires et les mettre en œuvre partout au pays et éliminer ainsi les inégalités.
Les Canadiens handicapés attendent depuis trop longtemps de faire partie d’une société pleinement accessible et inclusive.
Photo courtesy of Dj.092311, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons